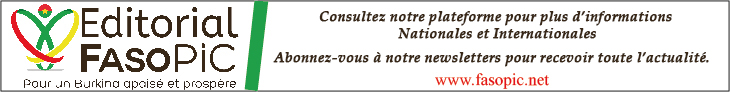[responsivevoice_button voice= »French Female » buttontext= »Ecouter l’article »]
Alors que le 33 tours Shakara lui donne une aura panafricaine, Fela Kuti a imaginé avec son orchestre une musique purement africaine : l’afro-beat. Du jazz, du highlife, de la juju, la musique yoruba, et du funk ramené de ses voyages sur la côte ouest des États-Unis. En cette fin des années 70, le Nigéria vit une véritable effervescence musicale. « Entre l’afro-beat, la juju, le highlife et la fuji, il y avait une profusion de styles et puis au milieu de tout ça, il y avait quelques branchés. Un guitariste de Fela, qui est passé ensuite chez King Sunny Adé, Bob Ohiri, avait fait tout un album de rock psychédélique », témoigne Martin Meissonnier, qui a travaillé avec les deux stars nigérianes.
Du rock psychédélique à la world music
Alors que le mot « jazz » a été synonyme de modernité pour les orchestres à la période des Indépendances, le psychédélisme gagne le monde entier. Du Nigéria jusqu’en Zambie, des chercheurs de vieux disques, les diggers, redécouvrent aujourd’hui l’influence de ce mouvement sur le continent africain1. Que nous racontent les deux volumes de la compilation Welcome to Zamrock ? De 1972 à 1977, la guitare « fuzz » a été un élément important du son de la petite industrie musicale zambienne. Très marqués par Jimi Hendrix et James Brown, ces rockeurs ont alterné entre la défiance et l’adhésion au pouvoir autoritaire du socialiste Kenneth Kaunda.
Tentative de rock panafricain initiée à Paris, le West African Cosmos reste anecdotique avec son mélange de funk/rock. Si bien qu’il faut attendre la world music pour que l’Afrique intéresse vraiment la sphère rock, à la fin de la décennie 80. C’est le moment où des stars africaines collaborent avec de grands producteurs anglo-saxons. « Les musiques du monde ne sont pas des musiques qui viennent des pays sous-développés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Tout le monde arrive avec un peu de choses et tout se mélange : la musique africaine, la musique bretonne, la musique anglo-saxonne. Mais ça n’a rien à voir avec ma musique locale, la musique sénégalaise, le mbalax », relève Youssou N’Dour, révélé dans les pays anglo-saxons grâce à Peter Gabriel et en France, à Jacques Higelin.
Mais peut-on parler de rock stricto sensu pour ces musiques du monde ? Quel rapport se joue entre les musiciens africains et les « toubabs » qui les produisent ? « Mon travail était de rendre ces musiciens célèbres, répond Martin Meissonnier. En studio, l’idée était d’enregistrer leur musique en les dénaturant le moins possible. Le boulot de production, c’est de se mettre au service de l’artiste. Par exemple, Fela m’interdisait de faire des versions 45 tours de ses morceaux. Pour lui, ses morceaux faisaient 20 minutes ou rien, on ne touchait pas sa musique. Alors qu’avec « Sunny » (King Sunny Adé, NDLA), on bricolait ensemble. Moi, je n’ai jamais vu cela comme de la musique africaine, mais comme des artistes différents les uns des autres. » Le grand combat de ce génial touche-à-tout sera d’imposer des artistes africains à des maisons de disques françaises voulant absolument les faire chanter… en français, au mépris de leurs langues d’origines.
La diversité des rythmes congolais
La vision du continent africain au sein de l’industrie du disque anglo-saxonne semble au contraire plus proche d’un « laisser faire, laisser être ». Cette méthode a été adoptée par Damon Albarn, le chanteur de Blur et de Gorillaz, qui a sillonné l’Afrique à la suite de son exploration du son malien, Mali Music (2002). Pour le projet Africa Express, imaginé avec le Français Marc-Antoine Moreau2, un train a sillonné l’Angleterre avec la crème des musiciens africains à son bord. Les chanteuses maliennes Rokia Traoré, Fatoumata Diawara, le joueur de ngoni Bassekou Kouyaté, ou les Congolais de Jupiter & Okwess furent de ce voyage achevé à Londres, le 8 septembre 2012, par un concert auquel participa l’ex-Beatles, Paul McCartney.
À propos de son « bofenia rock » sorti des rues de Kinshasa, Jupiter Bokondji remarque que « le plus dur, c’est de transcoder nos percussions pour des instruments modernes ». Issue des rythmes de la RDC, un pays qui compte pas moins « de 250 langues, 450 ethnies, et au moins dix à quinze rythmes par ethnie », sa musique s’est rockifiée en parcourant le monde. De quatorze musiciens jouant en acoustique, l’Okwess international, son groupe, est passé à six membres jouant en électrique. « Ce qui m’a séduit, c’est leur son, leur énergie. Pour moi qui n’aie pas une grande culture des musiques africaines, c’était du punk. Une musique rebelle, en dehors de la musique jouée par sa génération. On n’a rien inventé, tout était là », note François Gouverneur, l’ingénieur du son qui a parié sur le groupe avec Marc-Antoine Moreau.
Le rock des groupes africains tiendrait tout autant à leur attitude qu’à leur musique en elle-même. De Jupiter au guitariste touarègue Bombino du Niger, les musiciens interrogés ici ne se soucient pas vraiment d’une étiquette rock qui n’existe de toutes façons pas vraiment dans leur imaginaire. Dans Le nouveau dictionnaire du rock3, l’entrée réservée à l’Afrique fait cependant trois pages, sans compter les biographies de Ray Lema ou de… Fela Kuti.